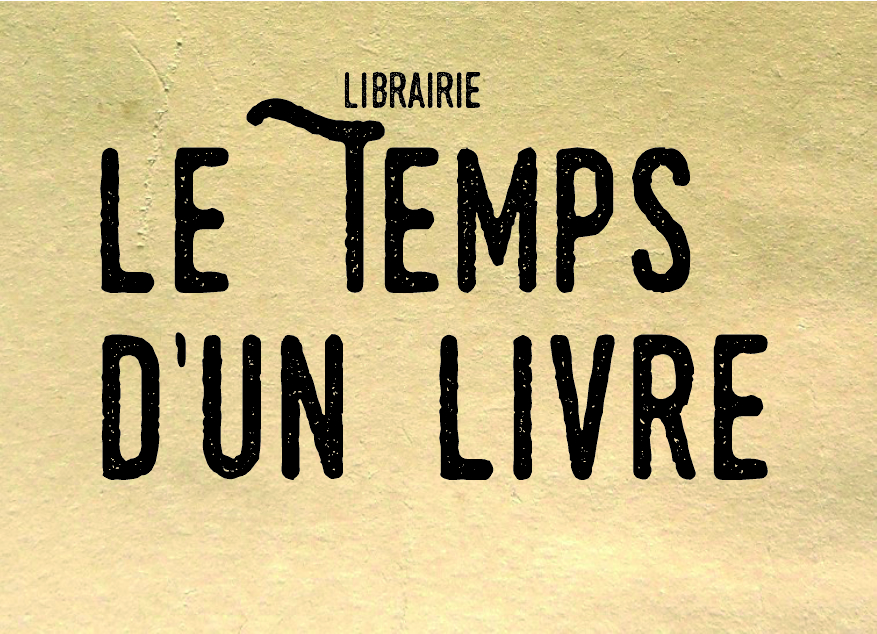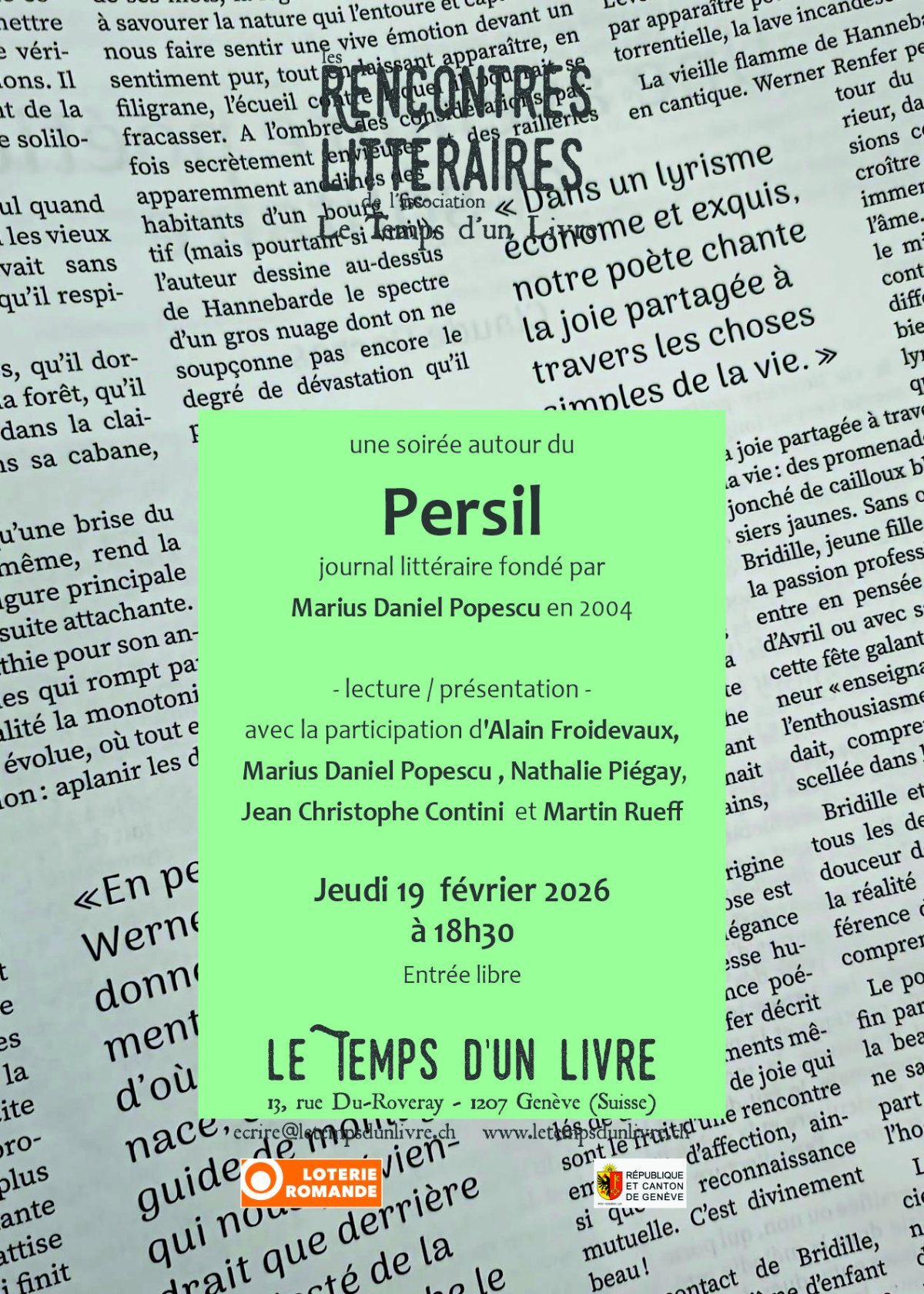Le Temps d'un Livre
du lundi au vendredi, de 10h à 19h sans interruption
et le samedi de 10h à 18h.
nos libraires aiment (beaucoup) :
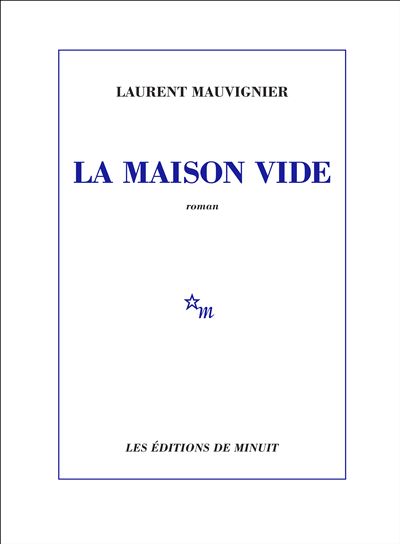
Laurent Mauvignier
La Maison vide(Minuit) 740 pages
L’extrait :
« (…) c’est ça, je ne fais que du roman –, mais je crois que que si ce que j’écris ici est un monde que je découvre en partie en le rêvant, je ne l’invente pas tout à fait : je le reconstruis pièce à pièce, comme une machine d’un autre temps dont on découvre que le mécanisme a pourtant fonctionné un jour et qu’il suffit de le remonter pour qu’il puisse redémarrer. Ce monde, je pars de sa disparition pour le reconstituer, peut-être à l’aveugle, en prenant trop de libertés, mais avec la conviction que je le fais dans le bon sens, comme à partir d’un fémur fossilisé le squelette d’un animal préhistorique que personne n’a jamais vu. ».
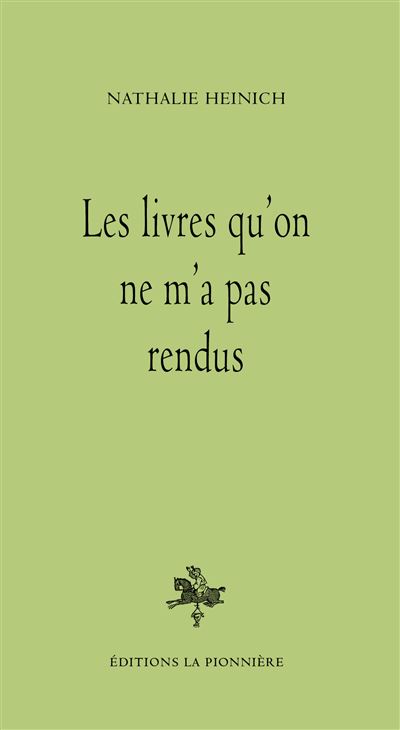
Nathalie Heinich
Les livres qu'on ne m'a pas rendus(La Pionnière) 44 pages
Dans ce petit essai autobiographique, aussi amusant qu’éclairant, Nathalie Heinich égrène les prénoms des débiteurs, retrouve les circonstances et les périodes des prêts, et, pour le plus grand plaisir du lecteur et de la lectrice, s’attarde sur les livres eux-mêmes : ce qu’ils étaient, ce qu’ils représentaient, la place qu’ils occupaient dans sa vie à ce moment précis. Des Armes secrètes de Cortázar (signé de la main de l’auteur !) à Aurais-je été résistant ou bourreau ? de Pierre Bayard, en passant par Vies minuscules de Pierre Michon, c’est toute une vie littéraire qui se donne à lire – une constellation de lectures, de rencontres et de bons (comme de mauvais) moments passés.
Ces pages font aussi ressurgir nos propres souvenirs. Pour ma part, j’ai prêté deux disques et un livre à une jeune femme à la fin des années 2000 ; lorsque nous nous sommes revus en 2020, elle ne semblait pas s’en souvenir – et moi, je n’ai pas osé les réclamer. Et l’écrivaine de nous confier encore que sa « (…) bibliothèque est un témoin, et les livres n’y sont pas que des livres, mais aussi des souvenirs, des preuves, des indices, des signes. »
Chacun trouvera matière à ruminer dans ce fantastique petit livre aux confessions réjouissantes, où ces « fantômes de bibliothèques » racontent quelques tranches de vie qui nous hantent. Merveilleux.
L’extrait :
« Il est toujours embarrassant de refuser de prêter un livre : on a tout de suite l’air mesquin. Mais quand même : le menuisier prête-t-il son marteau ? Le peintre, son pinceau ? La danseuse, ses chaussures ? Le cuisinier, son meilleur couteau ? La couturière, ses ciseaux ? La fée, sa baguette magique ? »
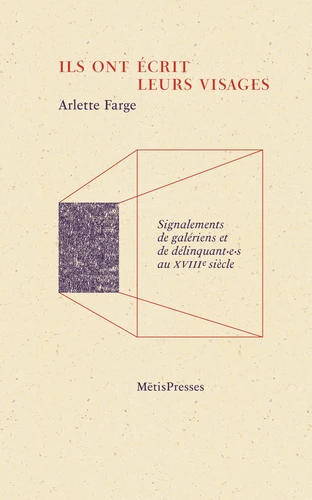
Arlette Farge
Ils ont écrit leurs visages : signalements de galériens et de délinquant.e.s au XVIIIe siècle(Métispresses) 116 pages
C’est aussi celui d’une société qui juge – souvent au faciès –, et qui compose ainsi un paysage singulier de malheurs et de turpitudes, peuplé de ces vies minuscules, privées de voix autant que de corps. L’écriture de Farge restitue à ces anonymes une présence fragile mais insistante, faisant surgir, à partir des archives judiciaires, une humanité effacée des livres d’Histoire en quelque sorte (ces vaincus chers à Walter Benjamin).
Dans sa postface, Karelle Ménine éclaire puissamment cette démarche : « Lorsqu’une époque perd ses repères, que l’actualité la percute avec violence, la société vient frapper à la porte de l’historien·ne en lui réclamant de comprendre ce que d’aucuns nomment des “retours de l’Histoire”. »
Essentiel par ce qu’il dit, bouleversant par la justesse de son regard, cet essai l’est aussi par l’objet qu’il est devenu. On peut, au passage, remercier les éditions MétisPresses de nous le délivrer sous la forme d’un petit livre élégant et soigné. Un vrai plaisir – pour l’intellect comme pour les yeux.
©Yann Courtiau 2026
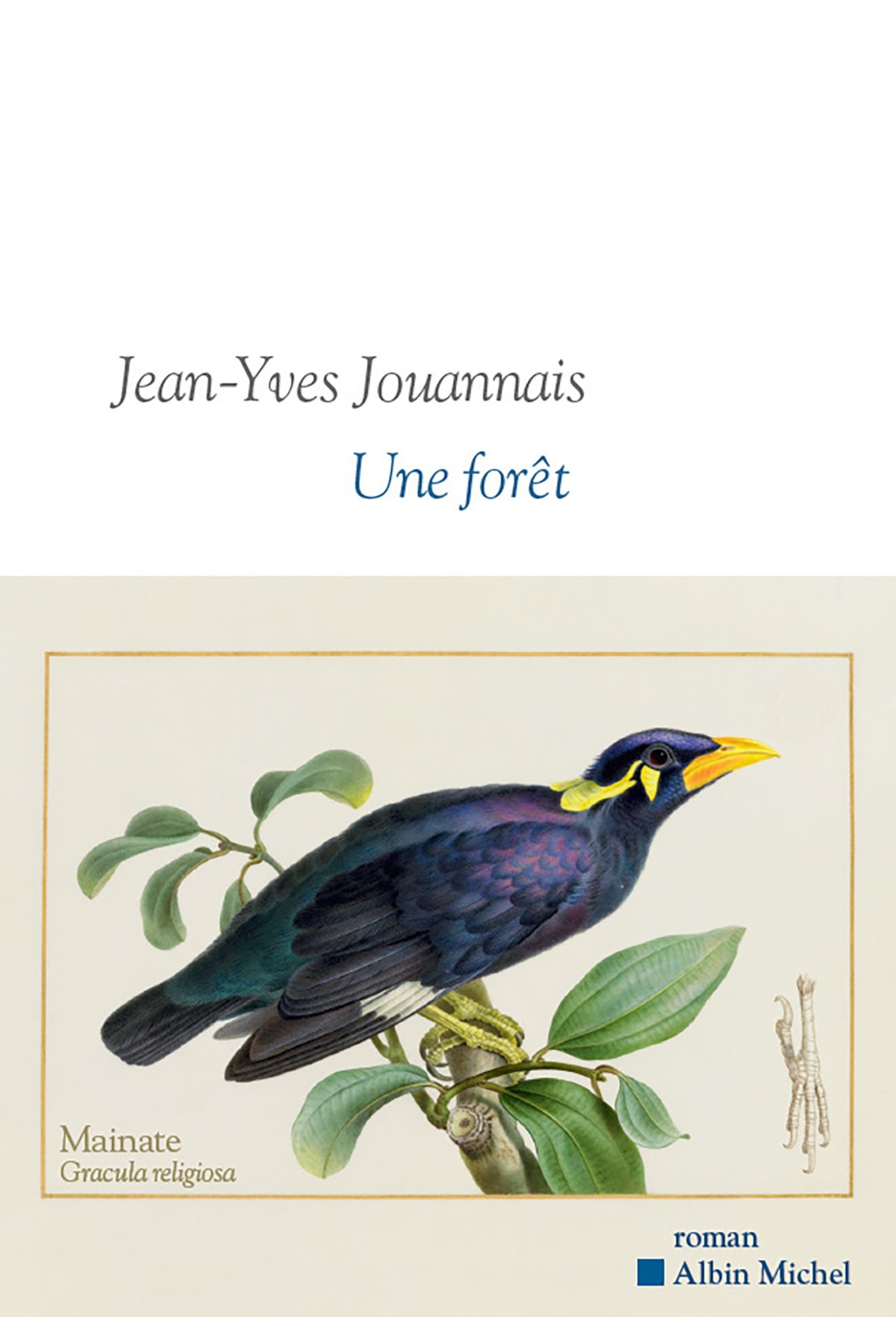
Jean-Yves Jouannais
Une forêt(Albin Michel) 106 pages
À travers un narrateur étrange, le capitaine Lenz – Américain parlant couramment l’allemand – Jouannais entraîne la lectrice et le lecteur dans un univers qui semble surgir de De la destruction de Sebald, ou encore du film Europa de Lars von Trier. Errance, étrangeté des paysages d’après-guerre, villes éventrées : tel est le décor d’un roman riche en anecdotes sur les incongruités des conflits et ce qu’ils laissent derrière eux. C’est aussi un roman sur la culpabilité et la tristesse.
Au cœur du livre, le réel et la fiction s’entrelacent dans l’histoire stupéfiante de mainates, capables de reproduire des mélodies humaines, et qui sifflent en toute naïveté, après la guerre, l’hymne nazi – le Horst-Wessel-Lied –, véritable casse-tête pour la commission locale de dénazification. Roman intrigant, Une forêt brille par sa singularité et par sa capacité rare à ne jamais s’enfermer dans un sujet unique, ouvrant au contraire mille et une pistes qui sont autant d'interprétation que de chemins pour se perdre. Réussite.
« Il s’était passionné, lors de ses étude à l’école militaire, pour les historiens de l’Antiquité, C’est en les lisant qu’il s’approcha au plus près, non pas de la littérature, mais – plus passionnant – du mystère du transport des récits. Il demeura dès lors hanté par des questions sans réponses. Il regrettait l’absence d’une science sérieuse dédiée à l’étude physique de la circulation, dans l’espace et le temps, des légendes, des fables, des histoires, et de toutes les figurent qui les animent. »
nos libraires aiment (beaucoup) :
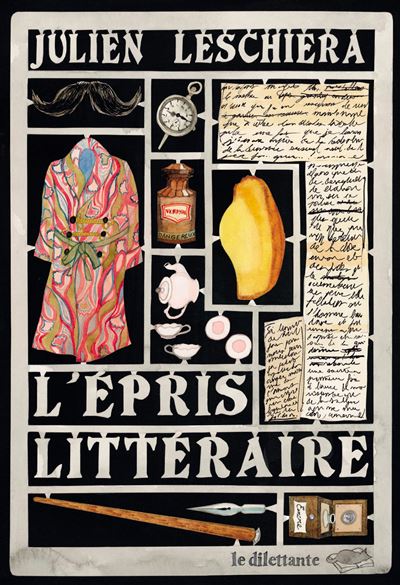
Julien Leschiera
L'épris littéraire(Le Dilettante) 268 pages
L’extrait :
« – Ne le prenez pas mal. Je vais m’expliquer pour être plus clair. Si vous rencontriez une personne qui vous racontait avoir découvert la valeur de l’engagement après avoir lu un texte politique, vous ne trouveriez rien de surprenant à sa démarche ? Une autre personne pourrait avoir retrouvé la foi en lisant un livre sacré et tout vous semblerait logique. Et n’importe quel voyageur qui vous dirait qu’il s’est mis en mouvement après qu’on lui a offert le récit de quelque écrivain nomade ne vous paraitrait pas plus fou qu’un autre. Appliquez cette logique à mon cas. J’ai vu un homme heureux au fond de son lit, nourri par des infusions et quelques douceurs, entouré de ses papiers… Et j’ai suivi ses pas, simplement. »

(Ates Sud) 162 pages
Dans la lignée du déchirant Tristesse de la terre, paru il y a une dizaine d’années – qui racontait la création du Wild West Show de Buffalo Bill et les derniers soubresauts de la conquête de l’Ouest américain – paraît aujourd’hui Les Orphelins, un livre-enquête où Éric Vuillard, fidèle à son art, déploie une plume acérée et malicieuse pour (re)donner voix à ceux que la légende a engloutis dans son tsunami de fantasmes, transformant les miettes de vérité en un socle pour un mythe au service de la « conquête » géographique : cet Ouest où, pour un temps limité, tout sembla possible, jusqu’aux pires atrocités, mais aussi la conquête des esprits, qui aiment penser que Billy the Kid fut une sorte de Peter Pan de la Frontière - en vérité un empire colossal fondé (volé) en moins d’un siècle...
Toute une cohorte de jeunes garçons vachers, mal nés, vagabonds, va ainsi faire l’expérience d’une liberté aussi extravagante que fugace : «(…) ils purent bouffer gratis, vivre au bordel, pioncer jusqu’à midi, se torcher la gueule, jouer aux cartes, buter n’importe qui, et surtout, ne rien foutre.» Jeunes et pauvres, ils mourront presque tous avant trente ans. Les survivants, après un détour par les forces de l’ordre, retourneront à leur point de départ – la misère – et raconteront ce qu’ils ont vécu, participant parfois eux-mêmes à la fabrication du mythe, jusqu’à finir par croire à leurs propres inventions.
Un livre tonitruant et magistral.
L’extrait :
« Le nom de Billy est un ressort. Il est le nom de la fiction proprement dite, il est le personnage par excellence. Il suffit de prononcer son nom et l’histoire commence. Il incarne la conquête, l’esprit d’aventure, l’individualisme naissant, avec son chatoiement de contradictions romanesques. George Coe ne ment pas, il ne fabule pas, il raconte, et la machine s’emballe, la machine à Billy, et elle nous sert inlassablement la fausse monnaie de nos rêves. »
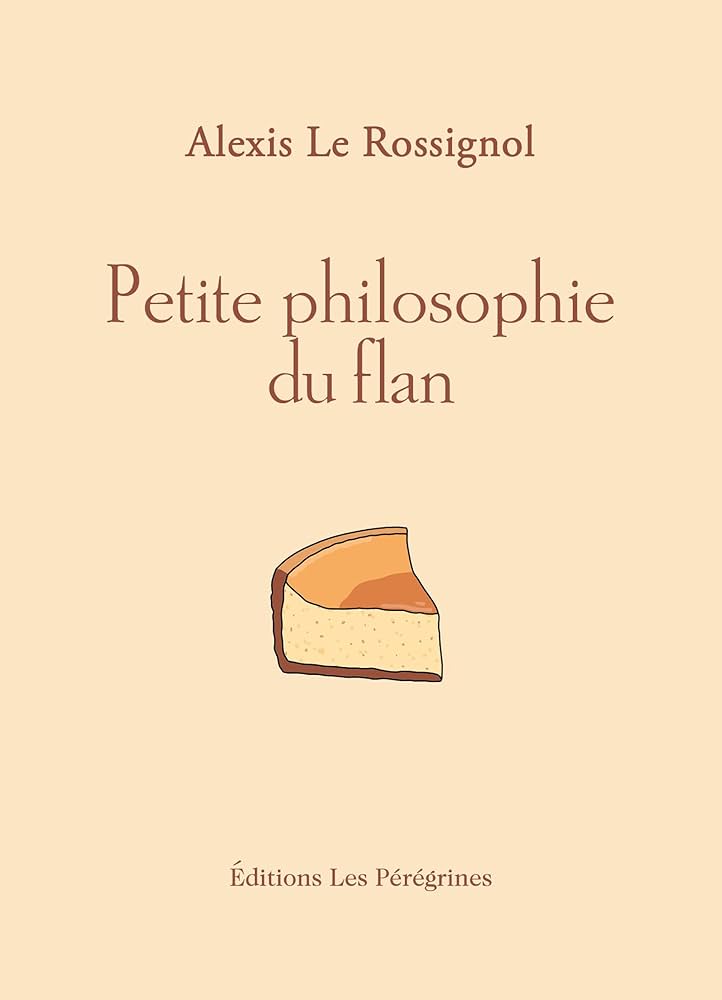
Alexis Le Rossignol
(Pérégrines) 166 pages
Les éditions Les Pérégrines n’arrêtent pas de nous surprendre, et on s’en réjouit. Après un Petit éloge de la procrastination, un autre sur le vin ou encore le feu de cheminée, sans oublier celui consacré aux anti-héroïnes de séries, voilà qu’elles ont mandaté l’humoriste Alexis Le Rossignol pour cette gourmande petite philosophie du flan, qui est un éloge mais aussi une réflexion des plus moelleuses puisque, pour lui (et je souscris) : « (…) dans un monde de plus en plus complexe, en manque d’horizon et de perspectives réjouissantes, les valeurs qu’il incarne, patience et douceur en tête, ont toujours des disciples. » Et ce livre en fera peut-être de nouveaux. Car si l’auteur en profite pour parler de lui (ce qui est bien normal), c’est toujours pour emprunter les chemins d’une pensée libre et amusante, vagabonde et néanmoins acérée –chemins qui ne conduisent pas à Rome mais plutôt à la pâtisserie du coin, où l’auteur dégustera, en fin connaisseur, sa part de flan.
Car oui, le flan incarne des valeurs, dont une majeure : l’inspontanéïté. « C’est une certaine idée de la liberté : il faut parfois avoir le courage de s’arracher à la commodité de la vie “normale” pour tracer son propre chemin. »
Ce livre, aussi drôle soit-il, permet de s’arrêter un moment et de se dire que l’essentiel est (parfois) dans la simplicité, incarnée (parfois encore) par le flan. Miam.
(Mon préféré ? le flan à la pistache de la Boulangerie Martine, Rue Jean-Violette 28, à Genève)
L'extrait :
« Or, s’il était humain, je crois que le flan ferait partie des lents : préparation lente, cuisson au four, temps de repos… Tout indique qu’il est de ceux qui ont besoin de temps pour bien faire les choses. Pourtant, il a réussi à se faire une place dans la société, et même mieux : à être un incontournable. Ce faisant, il démontre que le contre-pied est possible, et qu’il peut même être apprécié et valorisé. Oui, mais comment ? Eh bien c’est ce que nous allons voir. »
--
©Yann Courtiau 2026
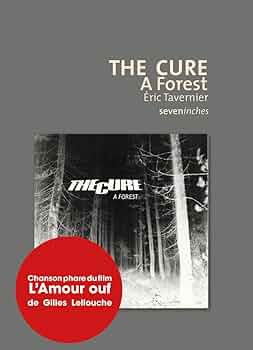
Eric Tavernier
THE CURE A Forest(Le Boulon) 128 pages
Évidemment, après le passage obligé des souvenirs personnels, l’auteur de ce petit livre provoque un joyeux réflexe pavlovien en renvoyant un bon demi-million d’anciens adolescents vers leur discothèque pour en ressortir les premiers disques du groupe. Moi aussi, j’ai eu quinze ans au mitan des années 1980 et me suis senti attiré par les mimiques de Robert Smith et cette musique qui me semblait à contre-courant de ce qui passait (aussi) à la radio : Dire Straits, Phil Collins, Modern Talking, Baltimora – et j’arrête là la torture.
Si vous avez grandi avec The Lovecats, In Between Days ou encore Lullaby dans votre walkman, vous avez remonté le courant tel un fringant saumon pour découvrir les trésors que sont – encore aujourd’hui – des albums comme Pornography, Faith et, surtout, Seventeen Seconds, cet album de 1980 qui est aussi ce moment précis où Robert Smith invite véritablement les Cure. Tavernier explique tout, dans le détail, ou presque ; il élargit la focale avant de zoomer à nouveau, resserre le propos puis lui donne du champ libre. Voilà un petit livre passionnant, bien écrit, érudit, malin, qui parvient à répéter l’essentiel tout en y ajoutant une touche d’inédit... Again and again and again and again…
L’extrait :
«En l’espace d’une année, ces musiciens avaient réussi l’exploit de faire prendre à leurs compositions un tournant vers quelque chose de nouveau, difficile à classifier. Pour comprendre les ressorts intimes de cette stupéfiante mue, il faut revenir sur les débuts du groupe puis sur ces quelques mois décisifs qui conduiront quatre individus et un producteur, dans un studio du nord de Londres, à nous permettre d’embarquer avec eux vers une merveilleuse terra incognita.»
nos libraires aiment (beaucoup) :
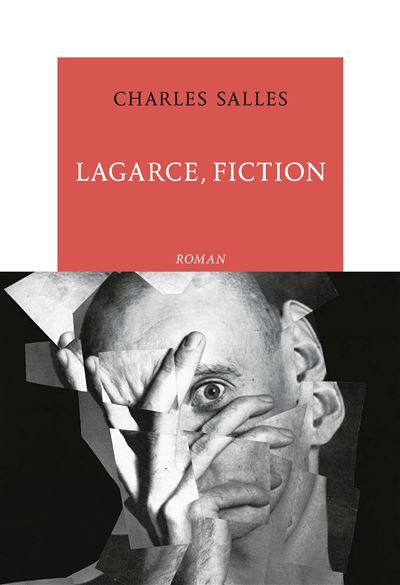
Charles Salles
Lagarce, fiction(La Table Ronde) 320 pages
L'extrait :
« Ce que nous retiendrons de lui ? Je l’appelais, sur le ton de l’humour, le protestant-juif. Il était sensible à l’oppression. Lors d’un enregistrement pour France Culture, il m’avait parlé de l’effet qu’avaient eu sur lui dans son enfance les récits de la Saint-Barthélemy. Il craignait plus que tout cette mécanique des foules jusqu’aux massacres. Il ne croyait pas au théâtre engagé, ses pièces ne parlaient pas de politique. En revanche, il était persuadé que l’art avait un rôle à jouer dans la chasse aux monstres. Je me souviendrais du chasseur de monstre. »
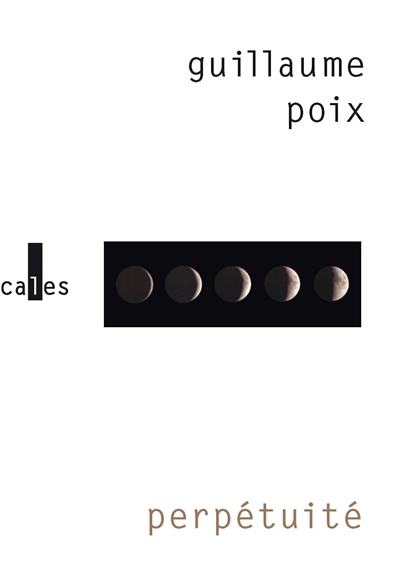
Guillaume Poix
Perpétuité(Verticales) 332 pages
Un roman noir? Certes. Il en a la tension, l’énergie et plaira sans nul doute aux lecteurs de polars comme de thrillers. Avec une particularité toutefois, qui fait son originalité: ce ne sont pas les détenus que l’on suit, heure après heure, dans ce lieu noir par excellence. Les gardiens de prison, les « matons » sont les personnages centraux du roman. Et parmi eux, beaucoup de femmes. Plus de la moitié.
On est happé dans cet univers toujours en tension, placé sur un qui-vive permanent, tenu par une langue d’une extrême justesse, qui transcrit nerveusement, densément, subtilement l’intensité de la prison, le sentiment d’oppression, la dureté des rapports tissés dans l’effort, leur fragilité aussi. Un roman sur la violence, celle qu’on tente de contenir, de réfréner, de contraindre et d’étouffer, la violence qui déborde et contamine, aussi.
L'extrait:
« Martine lui a passé le relais, il est seul à présent, gardien de la porte d’entrée principale pour la nuit entière, isolé, exposé comme aucun autre de ses collègues, à la merci des emmerdes s’il devait y en avoir - il n’a tout de même jamais connu de situation périlleuse (sur site, s’entend) en trente-deux ans de pénitentiaire, les drames, le concernant, ont eu lieu dehors, alors il n’envisage pas, préfère ne pas, l’urgence, le cataclysme, le drame qui viendrait lui ravir sa retraite et le tacler dans le dernier virage, lui qui n’a jamais redouté les services de nuit, trouvant même dans ce rythme contre-nature un certain équilibre, une manière épisodique en tout cas de se défier de la routine, de se voir vivre dans le noir, corps déformé, contours troublés, enfin se quitter, ne plus se ressembler et croire, malgré ls angoisses et les disproportions induites par l’obscurité, malgré le saccage de la perception, malgré les vertiges insurmontables, oui, croire qu’on n’est plus tout à fait soi et que les chagrins, aussi, se fondent dans l’informe. Du moins pour un temps. Avant que le jour n’aveugle et ne fusille le moral. »
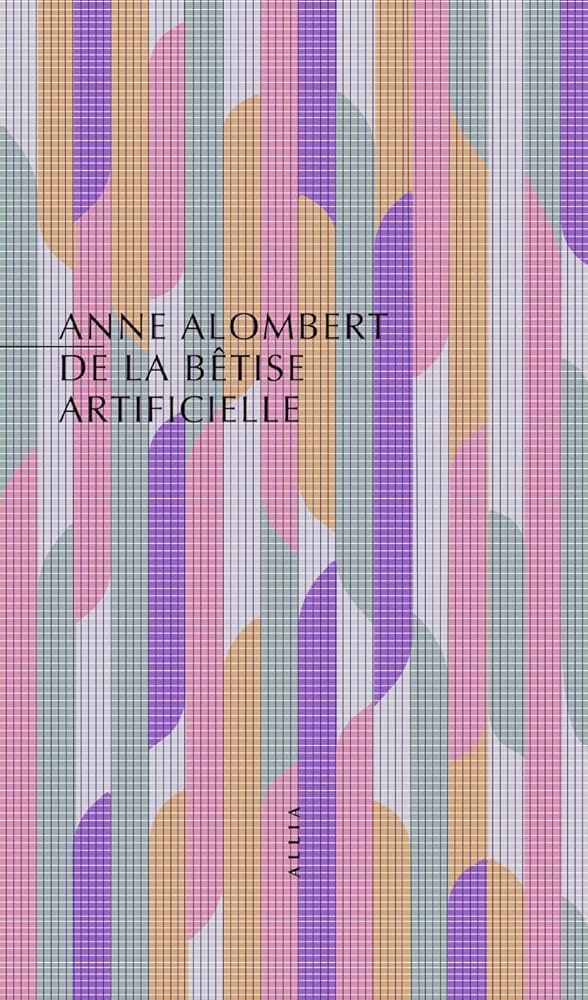
Anne Alombert
De la bêtise artificielle(Allia) 140 pages
L’extrait :
« Comme souvent, les innovations disruptives impliquent le remplacement des savoirs vivants et des organisations publiques par un capital fixe et des prestations privées : aux relations symboliques instaurées par les systèmes sociaux se substituent des relations consuméristes de services instaurées par des échanges marchands. Au lieu d’apprendre à produire des textes, des images et des sons, il s’agit désormais de passer commande à un service numérique. »
©Yann Courtiau 2025
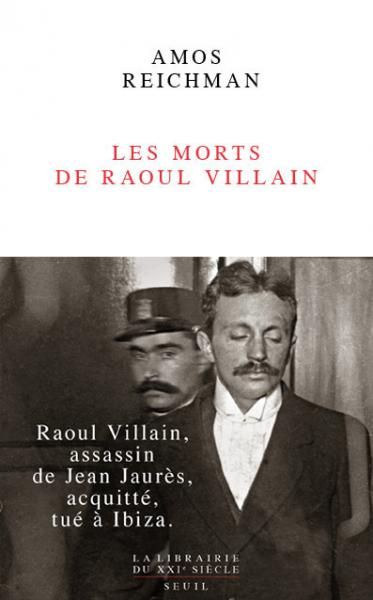
Amos Reichman
Les morts de Raoul Villain(La Librairie du XXIe siècle) 260 pages
nos libraires aiment (beaucoup) :
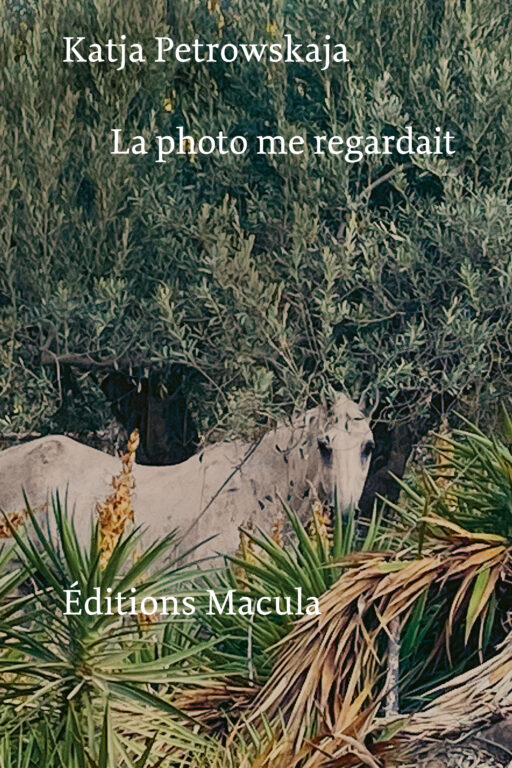
Katja Petrowskaja
La photo me regardait(Macula) 248 pages
--
Des photographies de Maya Deren , de Francesca Woodman, de la photographe géorgienne Natela Grigalashvili, du photographe et cinéaste suisse d'origine juive polonaise Helmar Lerski - dont le travail esthétique anticipe de façon saisissante (et paradoxale) celui de Leni Riefenstahl et Arno Breker -, des photographies anciennes, parfois de famille, actuelles, chinées, découvertes par hasard dans une bibliothèque, commentées avec finesse, justesse, intelligence et beauté – c’est là toute l’originalité et la force tranquille de ce merveilleux livre de Katja Petrowskaja. Il s’agit de déchiffrer ce petit bout de temps. Qui et quoi et quand au juste ? On est saisi de malaise en découvrant la photo de La « Course (cycliste) de la paix », à Kiev en 1986, alors que la foule n’est pas au courant de la catastrophe de Tchernobyl arrivée quelques jours plus tôt, puis on est ému par ce cliché d’un chanteur d’opéra – Moses LaMarr -, durant la tournée de l’Everyman Opery company, en manteau de couleur claire, dans la neige d’un parc de Leningrad en 1955, devant une audience d’enfants et de femmes éblouis et touchés de se trouver là, de voir un noir, d’entendre sa voix, son chant, situation œuvrant comme une l’image parfaite du « dégel » soviétique, même si cette tournée cachait un but politico-idéologique (pour les deux camps, comme l’explique si bien Katja Petrowskaja), mais qui s’en affranchit si bien, durant ce bref moment de contact humain. La Photo me regardait est un recueil de nouvelles et d’essais autant qu’un journal qui permet, lorsqu’on regarde bien – lorsqu’on y plonge ! -, de parler du passé, de penser le contemporain, d’évacuer comme de recevoir. 57 photographies et mille histoires. Sublime.©Yann Courtiau 2025
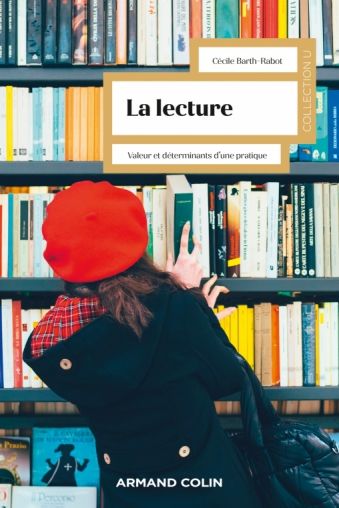
Cécile Barth-Rabot
La lecture(Armand Colin) 316 pages
--
Pour ce 23 avril, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, qui met en valeur l’écriture et – ce qui nous intéresse surtout : la lecture, il fallait bien se pencher un peu sur cette dernière, qui, précise l’autrice de cette passionnante recherche : «suscite une abondance singulière de discours, qui la décrivent comme menacée ou qui en vantent les mérites, et qui, se faisant, en soulignent et en renforcent la valeur. » Lecture et souci de soi, logiques de choix, postures, valeur et visibilité, etc. autant de chapitres qui permettent de définir avec autant de nuances que de détails cet « objet sacré » (ne pas prendre au sérieux) qu’est le livre, sa lecture (littéraire, si possible), ainsi que le lecteur lui-même. Mais cet essai qui a le mérite d’être exhaustif, a la particularité bien intéressante de démonter quelques clichés, notamment du rôle de la lecture scolaire ou bien celui des discours institutionnels ronflants du type « Lisez ! Vous en sortirez meilleur, grandi, cultivé », discours sensés s’adresser à toutes et tous et provoquez des envies de lecture, mais n’est entendu que par le (petit) public de convaincus – de lectrices et de lecteurs. Alors oui, sans aucun doute, la lecture peut constituer un refuge, une ouverture et un outil d’émancipation, mais cela tient à certaines conditions, aux dispositions de l’individu, au temps dont on dispose, etc. Comme le précise encore Cécile Barth-Rabot : « En d’autres termes, l’espace du lire n’est jamais donné, mais plutôt conquis et toujours doublement déterminé socialement par les dispositions des individus et leurs conditions matérielles d’existence. » Et plus loin encore : « Il s’agit donc pour un individu de trouver non seulement un texte qui lui convienne de manière générale, mais un texte qui soit adapté au moment considéré, qu’il puisse lire "à ce moment-là" avec plaisir et profit. La lecture, de Cécile Barth-Rabot, dans la collection U, Armand Colin, 316 pages essentielles (j’aimerais dire : obligatoires) pour tout professionnel du livre, surtout les institutions d’état, et autres férus de livres et de littérature - et de sa lecture, bien sûr.
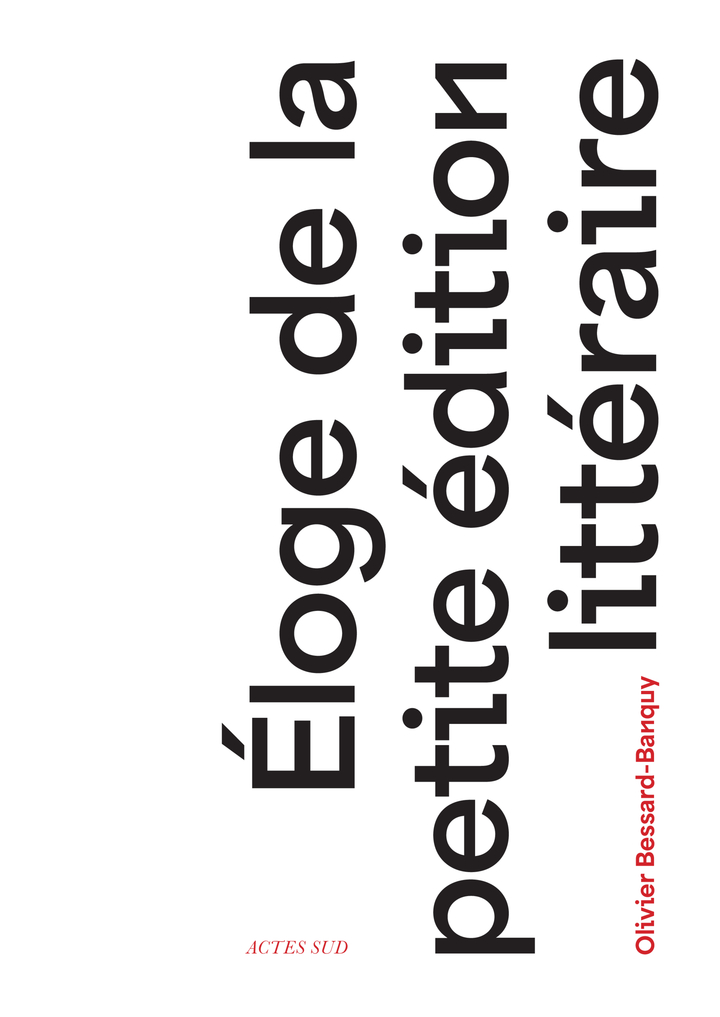
Olivier Bessard-Banquy
Éloge de la petite édition littéraire(Actes Sud) 380 pages
L’extrait :
« Partout sont apparues, depuis 1968, des maisons qui se sont fait connaître par leur art du livre et la révélation d’auteurs qui ont su attirer la curiosité des libraires comme des lecteurs, des professionnels comme du public, depuis les maisons évoquées jusqu’à Métailié, L’Arbre Vengeur ou Le Bruit du temps, des maisons qui, toutes ou presque, ont eu leur heure de gloire, leur réussite, signe de leur grand professionnalisme. En portant souvent des productions en marge, des formes inhabituelles, elles ont décongestionné la littérature, rappelé les autres types d’écrits variés qui peuvent constituer la richesse de tout ce qui existe en France aujourd’hui ; elles ont fait émerger le concept de « bibliodiversité » pour sortir du tout-roman standard, voir industrialisé ; elles ont, ce faisant, permis la richesse des œuvres hybrides qui sont sorties de terre, comme encouragées par ces nouveaux espaces de publication. »
©Yann Courtiau 2025
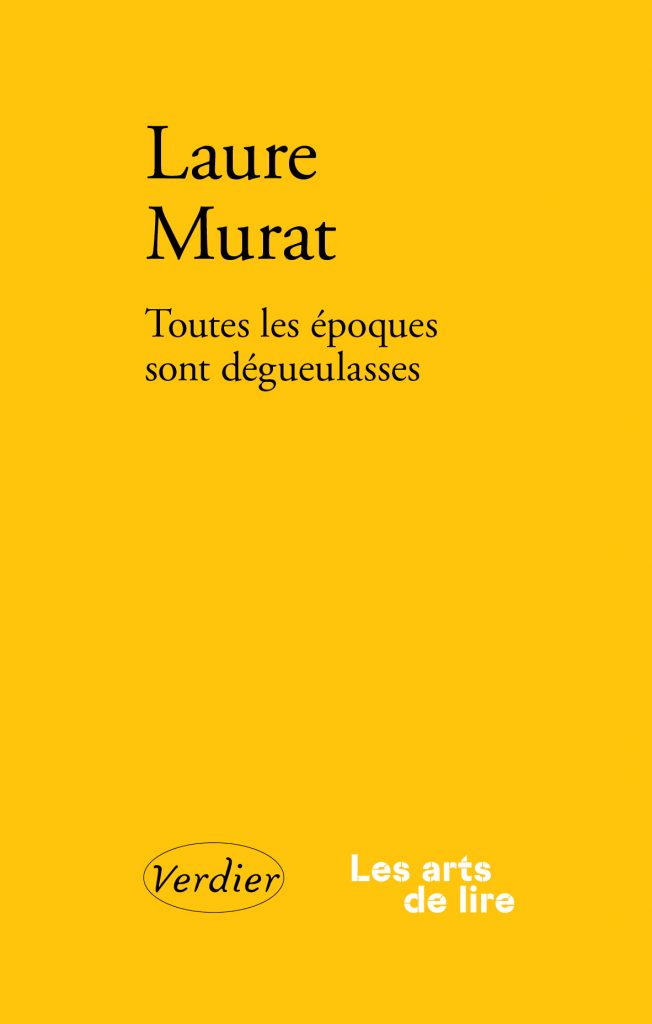
Laure Murat
Toutes les époques sont dégueulasses(Verdier) 76 pages
--
Courrez donc acheter cet essai de Laure Murat car il s’avère concis et bien utile pour replacer la parole comme la réflexion au-dessus du bruit ambiant qui noie tout débat intelligent au sujet de la récriture (ou pas) de classiques qui sonnent mal à nos contemporaines (et peut-être trop sensibles) oreilles ; après sa rapide et plaisante lecture vous en sortirez bien mieux informé sur cette réécriture au « goût du jour » (goût qui sera dépassé dès le lendemain) mais aussi pourquoi et comment on réécrit aussi pour vendre à nouveau, aux bibliothèques comme aux librairies, des histoires qui, dans leur nouvel emballage, seront adaptées fissa pour Netflix. Laure Murat argumente, tempère, justifie, contredit, souvent avec justesse, avec un rien de tempérament et un peu d’humour, permettant ainsi un point de vue plus net au sujet d’auteurs comme Roald Dahl, Ian Fleming ou encore Agatha Christie. Ni pour ni contre, bien au contraire.
©Yann Courtiau 2025